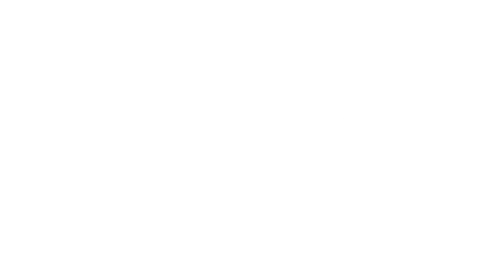Dans le sillage d’une nouvelle ère de la génomique et des tests génétiques, nous profitons tous des avantages de ce qui était autrefois un rêve lointain : la cartographie ancestrale, la manipulation génétique et la médecine personnalisée.
Cependant, les tests génétiques suscitent également de nouvelles questions éthiques et juridiques, parmi les plus notoires, la discrimination génétique. La discrimination fondée sur les caractéristiques génétiques pose de nouveaux défis, qui ne cessent de se développer. Les consommateurs qui ont passé un test génétique ou qui ont une prédisposition génétique à certaines maladies peuvent être victimes de discrimination de la part des assureurs, des employeurs et même du gouvernement, à leur insu.
Au cours des dernières décennies, plusieurs États et organisations internationales ont adopté des lois et des réglementations visant à prévenir de telles discriminations, comme la Déclaration universelle sur le génome humain et les droits de l’homme (1997), la Genetic Information Nondiscrimination Act of 2008 (GINA) aux États-Unis et la Loi sur la non-discrimination génétique au Canada (2017).
L’expert canadien en matière de discrimination génétique, Yann Joly, Ph.D. (DCL), FCAHS, Ad.E., de l’Université McGill, s’est entretenu avec Top Class Actions pour discuter de cette question omniprésente, notamment de ce que les Canadiens peuvent faire pour protéger leurs informations génétiques et si les tests génétiques présentent des risques.
Définition de la discrimination génétique

Si quelqu’un peut expliquer la discrimination génétique aux Canadiens, c’est bien Yann Joly. Il est le directeur de la recherche au Centre de Génomique et Politiques (CGP). Il est professeur agrégé au Département de Génétique Humaine de la Faculté de Médecine de l’Université McGill.
Parmi ses nombreux titres et accomplissements, Yann Joly est membre de la Commission Sectorielle des Sciences Naturelles, Sociales et Humaines de la Commission Canadienne pour l’UNESCO (CCU). Il est actuellement président du Groupe de Travail sur la Bioéthique de l’International Human Epigenome Consortium (IHEC) et co-dirige le Regulatory and ethics work stream de la Global Alliance for Genomics and Health (GA4GH).
Yann Joly est le chercheur principal du premier Observatoire de la discrimination génétique (ODG), et a publié de nombreux articles universitaires et de recherche sur la discrimination génétique.
Selon l’expert en génomique, définir la discrimination génétique n’est pas une tâche facile. « La discrimination est un terme tellement chargé, explique-t-il. [Il] peut avoir de nombreuses significations, selon la situation dans laquelle on se trouve. Si vous êtes une personne victime de discrimination, alors il a une connotation négative. »
Dans la situation décrite ci-dessus, Yann Joly souligne que la discrimination génétique désigne un traitement différent fondé sur des motifs illicites, en l’occurrence la génétique.
« Mais si vous êtes un scientifique ou un assureur, vous classez les gens dans différentes catégories », explique-t-il, et ce n’est pas nécessairement négatif.
Par exemple, les assureurs classent les assurés potentiels en fonction de facteurs actuariels, « qui font référence à des informations connues sur la santé d’une personne qui permettent de savoir si elle court un risque élevé de mourir plus tôt ».
De même, les scientifiques doivent classifier les personnes en fonction de la génétique pour aider à déterminer comment certains médicaments agiront sur les patients, dans le cas de la médecine personnalisée.
Tests génétiques, cancer du sein et le gène BRCA1
Yann Joly, de l’Université McGill, évoque un exemple courant de discrimination génétique dont vous ou une de vos connaissances avez pu être victimes.
« Une femme dont le test de dépistage du gène BRCA1 est positif, et qui est donc plus susceptible de développer un cancer du sein ou des ovaires plus tôt que la population moyenne, pourrait se voir refuser une assurance vie en raison de son risque plus élevé de maladie et de décès », explique-t-il.
Bien que les Canadiens et les Américains soient maintenant protégés contre de telles pratiques discriminatoires, note M. Joly, avant que de telles protections fussent instituées et dans les pays qui n’ont pas encore promulgué des interdictions de discrimination génétique, les compagnies d’assurance demandaient les résultats de tests génétiques ou exigeaient que quelqu’un subisse un test génétique avant de souscrire une assurance.
Selon le professeur et directeur de recherche, cette approche est erronée à deux égards. Premièrement, il y a un dilemme moral en jeu : « Vous avez déjà eu de mauvaises nouvelles, vous n’avez donc pas besoin, en plus, d’être refusé une assurance », explique-t-il. Par ailleurs, cette approche est également erronée sur le plan scientifique. « Avoir le gène BRCA1 n’est pas une condamnation à mort à 45 ans. Il y a beaucoup à faire pour réduire votre risque de maladie, comme des examens, des contrôles supplémentaires et une intervention chirurgicale. »
Tests génétiques et discrimination génétique au Canada
Bien que la discrimination génétique soit un sujet d’actualité au Canada et dans le monde entier, Yann Joly, de l’Université McGill, note qu’il n’existe pas de preuve concrète que la discrimination génétique est un problème répandu dans le pays.
« Il existe des preuves de discrimination dans le contexte de la maladie de Huntington », dit-il en se référant à une étude réalisée en 2009 par Yvonne Bombard. « Tout le reste est un grand point d’interrogation. »
M. Joly souligne que la Loi sur la non-discrimination génétique a été principalement conçue pour protéger les personnes dont les résultats des tests sont positifs pour certaines maladies génétiques. Il s’agit de « maladies génétiques rares monogéniques, comme la maladie de Huntington, le cancer héréditaire du sein et des ovaires (BRACA1) et l’hémochromatose. Ces affections sont protégées parce qu’elles sont faciles à discriminer ».
En outre, la loi s’applique spécifiquement dans le cadre de contrats privés, tels que les contrats d’assurance ou les contrats de travail. Par conséquent, M. Joly affirme que la loi canadienne sur la discrimination génétique serait « inefficace » pour empêcher la discrimination dans d’autres contextes et pour d’autres maladies.
Une grande lacune, souligne-t-il, est celle de l’intervention de l’État, comme l’immigration. « Il existe des preuves circonstancielles que des immigrants ont été invités à fournir des informations génétiques dans le contexte de l’immigration. Ils ne sont pas protégés. »
Protection de la vie privée : tests génétiques, analyse de l’ADN, 23andMe
Les tests ADN à domicile et les tests généalogiques, tels que Ancestry.com et 23andMe, ont connu une grande popularité ces dernières années. M. Joly prévient que 
« Lorsque vous décidez de passer un test génétique privé, comme ceux qui sont vendus en ligne, c’est une question de risque. Si vous décidez de procéder à un test génétique dans le système public, le risque que les résultats soient utilisés à des fins discriminatoires est très faible. »
Par exemple, les enquêteurs américains ont pu utiliser la plateforme de tests génétiques en ligne GEDmatch, pour tracer l’ADN du Golden State Killer, grâce à la libre disponibilité des informations génétiques en ligne.
Néanmoins, l’expert en génomique et en politique reste convaincu que, quel que soit le type de test génétique subi, le risque global reste assez faible. Son conseil : « Veillez à bien lire le contrat, afin de savoir dans quoi vous vous engagez. »
Les tests génétiques thérapeutiques, tels que les tests génétiques de dépistage du cancer du sein, sont une autre paire de manches, note-t-il. « Tout d’abord, c’est pour votre propre santé. Si votre médecin vous donne des conseils […], c’est à des fins thérapeutiques. Vous devriez passer le test. »
Yann Joly utilise une analyse des risques et des bénéfices dans le cadre des tests génétiques. Souvent, les avantages l’emportent sur les préjudices potentiels.
En outre, selon l’expert en génomique et en politique, il existe un lien entre la protection de la vie privée en général et la protection des informations génétiques : « Lorsque notre vie privée serait protégée à un niveau idéal, nous n’aurions pas à nous soucier de la discrimination génétique. Mais comme nous le savons, aujourd’hui, la protection parfaite de la vie privée n’existe pas. »
Discrimination, maintien de l’ordre et la discrimination intersectionnelle
Selon M. Joly, la discrimination génétique est intimement liée à l’intersectionnalité, qui se définit comme la nature interconnectée des catégorisations sociales telles que la race, la classe et le sexe.
« Ce sont toujours les mêmes personnes qui sont discriminées dans diverses circonstances. La génétique peut être utilisée pour exacerber d’autres types de discrimination », explique le professeur de l’Université McGill.
« Par exemple, aujourd’hui, les informations génétiques sont de plus en plus utilisées pour les enquêtes sur les scènes de crime. C’est formidable quand ça marche, et ça marche souvent. L’ADN est un identifiant unique, il peut donc vous dire si quelqu’un était sur la scène d’un crime […] Mais voilà le problème, prévient Yann Joly, dans les pays qui disposent de grandes bases de données génétiques […], l’ADN de centaines de milliers d’individus est stocké à des fins médico-légales, et certaines populations sont surreprésentées dans ces bases de données. »
On peut penser aux minorités visibles ou aux jeunes hommes, souligne-t-il, précisant que ces deux populations sont surreprésentées dans les bases de données génétiques médico-légales. « Cela crée donc un déséquilibre car cela signifie que l’ADN que vous devez examiner et comparer ne représente qu’une petite minorité de la population. »
Antécédents familiaux de maladie toujours non protégés
Bien que la Loi sur la non-discrimination génétique du Canada protège certaines formes d’informations génétiques, elle laisse un vide réglementaire béant en termes d’antécédents familiaux de maladies.
« Si vous savez qu’il y a des antécédents familiaux de cancer du sein, vous devez quand même révéler cette information à votre assureur car il ne s’agit pas d’un résultat de test, mais plutôt de renseignements génétiques. » Ce problème se pose lorsque des personnes n’ont pas passé de test génétique, mais connaissent leurs antécédents familiaux de maladie, ce qui constitue une forme d’information génétique qui n’est pas protégée par la législation canadienne en matière de discrimination génétique.
Bien que les antécédents familiaux de maladie ne soient pas protégés, l’expert en génomique et en politique convient que la Loi sur la non-discrimination génétique du Canada est un premier pas dans la bonne direction.
« L’avenir se dirige vers une époque où les tests génétiques sont de plus en plus précis. À mesure que les autres tests prédictifs médicaux s’améliorent, nous devons veiller à ce que ces tests soient utilisés au profit de la population et non pour exclure certaines populations de la vie sociale et d’autres sphères [en raison de la discrimination génétique]. »
Yann Joly offre ce conseil aux Canadiens qui ont subi ou vont subir un test génétique : « Traitez vos informations génétiques comme toute autre information sur la santé. Soyez proactif. Méfiez-vous des personnes, comme un employeur, qui demandent ce type d’informations et demandez pourquoi. Vérifiez si c’est légal. Lisez les termes de votre contrat et ne partagez pas plus que nécessaire. »
Envisagez-vous de subir un test génétique ? La discrimination génétique vous inquiète-t-elle ? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires ci-dessous !
Lisez plus sur les recours collectifs et les règlements :
- Recours collectif sur le Dodge Ram 1500 invoquant un défaut du refroidisseur EGR
- Avocat en invalidité de longue durée | Aide en cas de refus d’une demande d’assurance
- Allergan est poursuivie en justice pour des implants mammaires dangereux
- Assurance contre les pertes d’exploitation en cas de pandémie – poursuite canadienne potentielle
[legal_notice_french]